La Manufacture d'Opium à Saigon
Gouvernement Général de l'Indochine - 1906
Ce document "Note sur l'Opium" a été publié en 1906 par les soins du comité local chargé de préparer la participation de la Cochinchine à l'Exposition Coloniale de Marseille.
Il nous renseigne sur la manufacture de Saigon et sur l'histoire et la fabrication de l'opium en Indochine.
|
|
Ce document étant un fac-similé, les photos reprises ici sont d'une qualité moyenne. Malgré tout, cela constitue un rare témoignage de cette activité en Indochine. |
La Manufacture d'Opium de Saigon (en 1904)
"La manufacture d'Opium est située au centre même de la ville de Saigon. Elle occupe un espace presque rectangulaire, délimité par quatre rues, dont la superficie dépasse 1 hectare."

|
Entrée de la manufacture d'Opium |
| Intérieur de la manufacture (source caom) |
"Des constructions sont établies sur les 4 cotés de ce vaste triangle. Le 1er bâtiment, bâtiments de façade, comprends une porte d'entrée principale. Immédiatement à droite se trouvent tous les bureaux; bureaux du régisseur général du garde-magasin et des secrétaires. A gauche, c'est le logement de nuit et de jour des gardiens et, un peu plus loin, dans le même prolongement, commence le magasin général qui se continue sur le coté gauche par un autre magasin, dit magasin des sacs. Si l'on pénètre dans la manufacture, on voit une grande cour-jardin de chaque coté de laquelle sont placés deux constructions symétriques. Celle de droite comprend le logement du garde-magasin général, les salles d'encaissage et des expéditions ; celle de gauche, plus élevée, est à l'étage. Elle se compose du logement du régisseur général, du magasin des caisses d'opium brut et, en dernier lieu, du laboratoire de chimie."
Emplacement de la manufacture :
|
|
Le plus extraordinaire, c'est qu'une partie des bâtiments existent toujours aujourd'hui. Ils sont même préservés grâce à l'existence de quelques restaurants "branchés" qui ont trouvé l'endroit attrayant... Cela s'appelle "The Rafiney" et c'est face au Hilton, dernière l'opéra, en plein centre ville..
|
|
|
|
|

|
|
Vue des batiments |
"Faisant presque suite à ce bâtiment, on trouve une grande construction également à étage. Tout le 1er étage comprend une seule salle, très spacieuse, servant de magasin de dépôt aux récipients de chandoo. Le rez de chaussée est divisée en plusieurs salle, salles de pesages, de sertissage, de pasteurisation etc..
Tout à fait en arrière et face à la porte d'entrée est placé la salle des machines. C'est là que sont installées les deux puissantes chaudières fournissant la vapeur d'eau nécessaire à la bouille rie. Contiguë au hangar des machines, s'élève une construction de 50 mètres de longueur sur 20 mètres de large avec une toiture très élevée, muni d'un lanterneau : c'est la bouillerie d'opium. [..]"
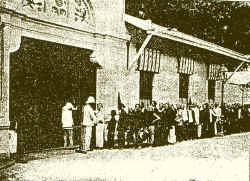
|
Sortie des ouvriers |
L'ouverture des boules ou pains d'Opium
Bouillerie

|
"La bouillerie est le bâtiment principal de la manufacture: c'est là ou se font toutes les manipulations que comporte la fabrication du chandoo." |
Refoulage
Emboîtage et pesage de l'Opium
Consommation de l'opium en Indochine
"L'Administration des Douanes et Régies vend, par l'intermédiaire des Receveurs, les boites d'opium aux consommateurs ou aux débitants qui tiennent des maisons spéciales, appelés fumeries.
En général, les chinois ou les annamites riches ou seulement aisés fument chez eux ; mais les indigènes de la classe pauvre, ne possédant pas l'appareil du fumeur, vont fumer dans les fumeries.
Les fumeries sont très nombreuses en Indochine, on les rencontre un peu partout, principalement à Saigon et à Cholon. Ce sont des locaux assez vastes presque toujours étroites et profond. "
Historique de la régie de l'Opium
"En 1861, lorsque la Cochinchine devint possession française, l'opium y était peu en usage ; inutile de dire qu'il n'y avait aucune manufacture. Les quelques fumeurs annamites, cambodgiens et chinois achetaient leur opium tout préparé à des marchands qui étaient autorisés, moyennant une assez forte redevance, à importer leur produit et à le vendre. Ces redevances constituèrent pendant longtemps le plus clair des revenus des mandarins.
Avec la conquête arriva l'immigration chinoise et de ce jour l'opium fut consommé d'une manière courante.
L'Administration de cette époque comprit immédiatement tout le parti qu'elle pouvait tirer de la vente de ce produit, mais au lieu d'établir un droit de vente, elle préféra, comme pour la plupart des impôt indirects, recourir au système de fermage. A l'origine, la ferme fut donnée, de gré à gré, à deux français contre le paiement d'une redevance annuelle de 92.000 piastres. Malgré les conditions avantageuses de leur marché, les fermiers eurent toutes sortes de déboires.
Le pays n'était pas encore pacifié, divers postes furent pillés, des employés tués, et une transaction intervint en leur faveur. Par suite de cette transaction, ils n'étaient pas complètement indépendants du Gouvernement, celui ci devant avoir une part dans les bénéfices. A la fin de la 1ere année, ils durent fournir des comptes qui provoquèrent de la part de l'administration une action en justice.
Ils furent condamnés par un jugement régulier pour avoir voulu frauder l'État et la ferme leur échappa.
Ceci se passait en 1864. Instruite par cette 1ere expérience, l'Administration résolut de recourir à l'adjudication pure et simple et la nouvelle ferme de l'Opium fut donc mise en adjudication publique pour une durée de 3 ans.
Dès la 1ere adjudication, elle tomba entre les mains de plusieurs chinois qui installèrent une manufacture à Cholon. Cet immeuble existe encore aujourd'hui [NDLR en 1905....] et l'on peut voir les ruines. Cette manufacture fut la 1ere établie en Cochinchine."
"Plusieurs adjudications se succédèrent ensuite sans augmentation notable de la redevance annuelle, malgré l'accroissement continuel de la vente. Il était certain qu'il y avait entente entre les chinois et cela aux dépens des finances de la colonie. Aussi, lorsque l'Administration fut procéder, le 20 janvier 1881, à une nouvelle adjudication pour la période triennale commençant le 1er janvier 1882, elle fixa à 7 millions de francs le prix de base pour l'affermage de l'opium en y joignant celui des alcools. Ces conditions étaient sensiblement plus élevées que les précédentes ; les chinois protestèrent et ne soumissionnèrent pas ; l'adjudication ne donna aucun résultat.
Le gouvernement Le Myre de Vilers, qui avait reconnu les graves inconvénients du fermage comme mode de recouvrement de l'impôt sur l'opium, tant au point de vue politique que sous le rapport financier, n'hésita pas à profiter de la circonstances pour abandonner ce mode de perception. En vertu du décret du 8 février 1880, instituant un conseil colonial en Cochinchine, il convoqua cette assemblée en session extraordinaire pour l'appeler à se prononcer sur cette question.
Le Conseil colonial émit l'avis que le monopole du commerce de l'opium, laissé entre les mains d'étrangers chinois, pourrait bien avoir à un moment donné des inconvénients sérieux pour l'influence française en Cochinchine, aussi bien pour le développement de la prospérité commerciale du pays et, à l'unanimité des votants, se prononça pour la régie de l'Opium. [...]
Dans cette même année 1881, on construisit une manufacture au centre de la ville de Saigon. Le 1er janvier 1882, tout était terminé et la régie directe entrait ce même jour en vigueur en Cochinchine.
Malgré les difficultés et les déboires inhérents à toute nouvelle entreprise, l'opium mis en régie rapporta bien plus qu'avec l'ancien système et les espérances les plus optimistes furent dépassées. Cependant, l'administration ne put se passer immédiatement de tout concours étranger dans la nouvelle organisation. La préparation proprement dite, avec toutes les manipulations qu'elle comporte, resta confiée à un adjudicataire chinois qui était payé 0,50 frs par kilo de chandoo achevé ; ce ne fut que beaucoup plus tard, en 1891, que l'administration décida de se passer de cet intermédiaire, et à diriger elle-même son exploitation.
Depuis 1882, époque de sa création, jusqu'en 1904, la manufacture d'opium a subi de nombreuses transformations. En 1897 particulièrement, par suite de la suppression de deux manufactures, celle de Luang Prabang au Laos et celle de Haiphong au Tonkin, on procéda à quelques agrandissements et entre temps on apporta quelques modifications au mode de fabrication du chandoo."