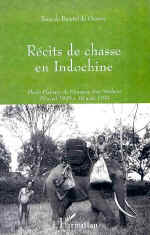
Récits de chasse en Indochine
René de Buretel de Chassey - Haut Plateaux de l’Annam, Ban Méthuot, 29/4/1929 - 10/08/1931.Edition L'Harmattan - 5-7, rue de l'École Polytechnique -75005 Paris. Paru en 1998. 118 pages + annexes.
Résumé
"Le lieutenant René de Buretel de Chassey a 24 ans lorsqu’il débarque en Indochine. Il est affecté à Ban Méthuot, chef lieu du Darlac, une des 16 provinces de l’Annam, à 300km au nord est de Saigon.
Le Darlac, situé sur les Hauts Plateaux, est une région sauvage, très giboyeuse et peuplée de tribus aux moeurs primitives, les Mois. Se prenant à aimer le pays et ses habitants, René de Chassey deviendra chasseur et, à se façon, ethnologue."
EXTRAITS
Chasse aux tigres :
"Le tigre attaque sa proie et a l’habitude de revenir plus tard pour finir son festin. Il s’agit donc de construire un mirador à 6 mètres de la proie et à 3 mètres de hauteur. Juste une plate-forme horizontal de dimension très restreinte, juste de quoi s’asseoir, jambes pendantes.
Avec un peu de chance, le tigre se présente, sans un bruit.
Il n’y a pas de doute, c’est le roi de la jungle. Il est arrivé sans faire de bruit, malgré les feuilles sèches jonchant le sol. Il y en a même deux. J’en ai entendus un qui fait le tour du cheval et, méfiant, vient renifler les alentours et en particulier l’arbre où je me trouve. L’autre, sans doute un jeune inexpérimenté, va droit au cheval et ne bouge pas ; il doit le sentir. L’instant est propice. Je prends doucement ma torche électrique et mon fusil de chasse ; malgré toutes mes précautions, le tigre qui était sous mon arbre a dû entendre, car il fait un bond ; il en fait un deuxième au moment où j’allume ma lampe et la braque sur le cheval. Le deuxième tigre est toujours là, semblant la charogne de cheval et s’apprêtant à l’entamer. Il est complètement de profil et ne détourne même pas la tête vers la lumière qui l’enveloppe. Je le tire aussitôt. Il tombe sur le coté, remue un peu le bout des pattes et ne bouge plus au bout de 20 secondes.
Il doit être mort. J’éteins ma lampe et attends encore une heure espérant que l’autre fauve reviendrait.
Ne le voyant pas revenir, je descends du mirador et regagne le village où je reprends mon cheval. Je rentre seul à Ban Méthuot.
Le lendemain matin, je reviens sur les lieux de la veille. La bête était jeune, quoique ayant environ 1,60 mètre de la naissance de la queue au museau, par contre la peau était bien fournie et les rayures très marquées. Tout est muscle chez cet animal et 4 hommes ne sont pas de trop pour le transporter. Je fis dépecer la bête sur place, avec tout le soin possible, laissant aux indigènes la viande, j’emportait la peau et le crâne. [...] Son compagnon (sa mère ?) était revenu la nuit sur le cheval, en avait mangé un morceau et avait également léché son camarade mort, car les poils étaient couchés et humides.
En somme rien d’extraordinaires dans cette chasse, qui m’a produit aucune émotion. Le plus difficile, d’ailleurs, n’a pas été de tuer la bête, mais d’en préparer et d’en conserver la peau, ce qui m’a demandé 48 heures d’efforts et de surveillance continue."
La Chasse à l’éléphant
On ne chasse que les mâles !
 |
Scéne de départ en chasse |
 |
Le courrier chargé sur un éléphant ! (photo extrait de l'ouvrage) |
La chasse au bœuf sauvage (le gaur).
Les sens sont extraordinairement développé chez le solitaire et il est difficile de le chasser.
 |
Un gaur en trophé ! |
Chasse au crocodile
"La descente du Krông Ana s’effectue assez vite. Nous nous arrêtons en route pour manger sur une petite plage. Notre déjeuner se compose de morceaux de sarcelles grillées à un feu de broussailles et de riz à la Moï. Vers 15h, j’aperçois un crocodile endormi sur une petite plage de sable. Les pagayeurs cessent de pagayer et la pirogue descend au fil de l’eau sans aucun bruit. Je prends ma Mauser 10,75 et tire à 40m visant la tête du saurien. Etant donné le déplacement d’un tireur par rapport au but et le mouvement du balancement latéral de la pirogue, ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire.
La bête au choc de la balle blindée reste immobile. Je la crois déjà morte lorsque je la vois remuer et tourner la tête vers le fleuve pour y descendre. Alors à 15m je tire une deuxième balle avec une cartouche 8m/m demi-blindée dans la région de l’œil. Le monstre se débat sur place. Je l’achève à quelque deux mètres d’une troisième balle dans la cervelle. Mon ordonnance rhadé qui n’avait jamais vu, surtout d’aussi près, un saurien de cette taille, était loin d’être rassuré. Je fis couper la queue pour les coolies Mnongs Rham qui mangent la chair de cet animal."
17/10/1930 Achat d’une femme rhadée.
" Le capitaine Turquin est parti ce soir en auto voir les parents de son ordonnance. Il a déjà échangé avec eux quelques cadeaux ; ceux ci lui ont donné : des citrons, des courges, du riz des œufs des légumes rhadés (potiron), des poulets ; celui-là leur à donner quelques piastres. Il est revenu à Buôn Ky avec une femme rhadé. Voici la scène : il est entré dans la case du chef, puis après quelques paroles, il a demandé s’il était possible d’avoir une femme pour emmener à Ban Methuot. Aussitôt une vieille femme est sortie et est rentrée peu après avec une jeune fille (c’est à dire non encore mariée), habillée avec apparat : veste, robe (très belle ouverture), anneaux d’étain aux pieds, coiffure bien faite. Elle a le visage peu agréable et la peau brune. Le marché fut conclu assez vite : le Cne donnerait 15 piastres par mois à la famille.
Le soir même, il la lavait à grande eau chaude avec du savon de Marseille. "
Juillet 1930. Un français au service des tribus : Léopold Sabatier
"Léopold Sabatier ! Un nom qui mériterait d’être mieux connu. Un homme qui a œuvré magnifiquement pour la plus grande France. Un homme de mérite et de cœur trop modeste, qui a consacré 10 ans de sa vie au Darlac et a été payé d’ingratitude.
En 1914, le Darlac faisait partie de la province de Kontum. Un délégué placé à Ban Méthuot l’administrait.
L’administrateur Sabatier prend la tête de la légation au Darlac en 1914 ou 1915 et en conservera l’administration lorsque cette délégation est transformée en province.
Le Darlac avait à ce moment des régions insoumise, c’est-à-dire non reconnues et occupées, et touchait au pays insoumis des Mnongs. Ce pays a été appelé ensuite, en 1932 au moment des opérations de police faites par le bataillon tirailleurs cambodgiens et le bataillon de tirailleur montagnards du Sud Annam : " région des trois frontières " car il était à cheval sur la Cochinchine, le Cambodge et l’Annam. Il était marqué en blanc sur les cartes.
L’administrateur Maître l’avait exploré en plusieurs campagnes entre 1909 et 1914. En 1914, en pleine guerre, il était assassiné par un chef de tribu nommé Pon Trong -Loung. Il ne fut vengé qu’en 1935, après la réduction du soulèvement des tribus qui avaient attaqué le poste Le Rolland le 4 mars 1935. Le Darlac en 1915 était complètement fermé. Peuplade aux moeurs et coutumes intactes, vivant comme il y a 2000 ans.
Plusieurs tribus peuplent le Darlac. La principale, celle des Rhadés est la plus évoluée et la moins frustre. Sabatier prend en main cette province ayant pour but d’amener, progressivement et après éducation préliminaire, les aborigènes du pays au stade de l’âge de fer à celui de l’électricité - 2000 ans à franchir ! Cela il veut le faire en vase clos, à l’abri des invasions européennes et annamites. Un seul européen est supporté par lui : un inspecteur de la garde aborigène. Les docteurs et commerçants sont découragés rapidement. Il bâtit, fonde l’école avec ateliers de bois et de fer, développe l’agriculture, met par écrit la langue purement orale des rhadés, recueille leurs légendes et leur droit coutumier, rend la justice établit l’impôt.
Tout cela, il le fait avec le seul impôt qu’il recueille dans sa pauvre province, sans demander un sou à Hué.
En 1930, on vivait encore sur ce qu’il avait crée.
Enfin, il fait une route pour relier Ban Methuot à la coté d’Annam. La seule chose qu’il regrette d’ailleurs, car elle a permis aux blancs rapaces et insatiables de constater la présence de terres rouges du plateau Moi, propice à la culture du café et du thé.
Le 1er janvier 1926, il réunit tous les chefs du canton la province et leur fait la palabre du serment de fidélité à la France, qui reçoit l’approbation du Résident supérieur de l’Annam, alors M. Pasquier.
En 1927, il est l’objet d’une interpellation à la Chambre des Députés.
Puis sans raison, il est remplacé et envoyé en Annam avec le titre d’Inspecteur des Affaires politiques et administratives. Monsieur le Gouverneur Général Pasquier ne l’a soutenu qu’en paroles.
En 1930, il est chargé par le gouvernement d’une mission linguistique et ethnographique au Darlac en vue de l’exposition Coloniale. Mais on a peur de lui et de son influence sur ses anciens sujets. Le Résident Thièbaut lui interdit de quitter Ban Méthuot et le fait surveiller nuit et jour par un garde indigène.
[...]
C’est lui qui a découvert le matriarcat chez les Rhadés, que n’avaient pas soupçonné ses prédécesseurs.
Il a découvert également l’esclavage qui existe toujours, surtout sous la forme "paiement de dette ".
Un jour, il souhaite obtenir deux récoltes par an de riz dans les rizières irrigables des bords du lac, et donna des ordres et les moyens nécessaires aux chefs de villages. Une seule récolte sortit seulement dans l’année, car elle suffisante pour les riverains du lac pour préparer nourriture et alcool de jarre. Alors, Sabatier mit les chefs de village en prison, en leur disant :
- Vous sortirez de là, lorsque les deux moissons seront sorties cette année !
II y eût deux récoltes cette année là et les suivantes. Elles servaient en cas de disette dans une contrée de la province à assurer la soudure avec l’année suivante.
D’ailleurs, pourvoyant largement sa prison provinciale, assurait ainsi une main d’œuvre gratuite avec laquelle il réalisa de nombreux édifices sur pilotis, à la mode rhadé, une piscine, des routes avec trams (abris) tous les 25 km.
Il créa un corps de ballet, avec des jeunes filles du pays.
Souvent il donnait alerte la nuit à son peloton de Garde Indigène, le tenant ainsi en haleine.
Très fort en gymnastique, ancien élève de Joinville-le Pont, il pratiquait les agrès tous les matins, dressant les écoliers Rhadés lui-même.
Marié avec une radhé de Ban Don, il en eut une fille, qu‘ il fit élever en France et dont il épousa la gouvernante afin de lui laisser un nom.
Il en parle dans " La palabre du serment".
Connaissant à fond le dialecte rhadé, il le transcrivait en français, permettant ainsi de conserver les légendes, histoires, orales, chansons.
Son œuvre écrite est assez importante. Les principales productions sont :
- La légende de Damson
- Le Biduê (recueils de lois coutumières).
- Palabre du serment (recueil des discours prononcés à l’assemblée des chefs en 1925 pour leur indiquer ce qu’il y avait à faire dans tous les domaines).
- Lexique franco-rhadé.
- Une grammaire et un dictionnaire avaient été commencés, pour le compte de l’Institut d’Ethnologie, 191, rue Jacques à Paris, directeur : M Rivet. Ils n’ont pas paru.
M Sabatier à qui j’avais écrit en 1932, en rentrant en France, rn‘a déclaré vouloir tout oublier de sa vie d’administrateur en Indochine. Il s’était retiré à Montsaunés (Haute Garonne). "
La cérémonies de l'alcool des Jarres
"A 16 H, je reprends l’auto avec mon ordonnance, lequel conduit. Nous allons à B. Kram, situé au km 13 sur la route du lac. La famille de mon ordonnance fête la fin de la moisson de ses rays. Pour cela au matin, on a sorti 5 jarres.Quand nous arrivons, elles sont toutes entamées et presque finies. En mon honneur, on en remet une neuve. On la débouche, on y met des feuilles, on y verse de l’eau et on y plante un bambou creux qui sert à inspirer le liquide.
Le chef de la maison me fait savoir qu’elle désire " ewat aê ", c’est à dire appeler la faveur des dieux pour que je reste en bonne santé. J’acquiesce volontiers. Alors on apporte un poulet vivant. Un homme sachant la prière le prend entre les mains et le tient au-dessus de ma tête pendant que je suis assis face à l’Est, le dos tourné à la jarre. Il appelle d’une voix chantante sur deux tons tous les génies des cieux, de la terre sur moi ; cela dure 10 minutes. Ensuite je m’assieds face à la jarre, tenant le bambou siphon ; mais avant de boire, l’homme prend un bracelet de cuivre et me le passe au poignet droit en récitant encore une prière, moins longue. Ce bracelet, c’est " Kong ewat ". C’est le signe qui permet aux génies de me reconnaître et de m’épargner. On peut le porter ou le laisser dans la maison. Il sert ensuite pour une au cérémonie identique.
Je bois une grande corne (1/2 litre bien plein). On mesure cela d’une façon uniforme dans toutes les peuplades Mois à mesure que l’on boit par le bambou creux, le niveau de la jarre baisse ; un homme est spécialement chargé de la rétablir laissant tomber de l’eau à volonté par un trou creusé à la pointe de la corne qu’il bouche plus ou moins avec le doigt. On remplit cette corne avec un bambou creux orné de dessin gravés au couteau sur la partie cylindrique !
Le chef de village vient s’asseoir à côté de moi et boit une corne. J’en bois encore une et il en boit une ; j’en bois une troisième et lui également. C’est un maximum que je ne peux pas dépasser. Cette façon de boire à deux est signe d’ amitié non de fraternité ; ceci donne lieu d’ailleurs à une autre cérémonie.
Mon ordonnance en boit un peu et moi après lui. J’achète quelques pipes sculptées et nous repartons sur Ban Méthuot, mon ordonnance conduisant. L’alcool de jarre n’est pas fort (7°) ; quand il est bien fait, il est doux, ce qui est rarement le cas. J’emportai le poulet du sacrifice, car je dois le manger ensuite. "
 |
Scène de libation dans un village au Tonkin |